- AUTODÉTERMINATION
- AUTODÉTERMINATIONAUTODÉTERMINATIONLe droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (autodétermination) découle directement du principe de la souveraineté nationale, proclamé explicitement par la Révolution française. Il s’ensuit que les gouvernés doivent participer à l’élaboration des décisions qui les concernent et, par voie de conséquence logique, qu’une collectivité a le droit, quels que soient les traités et conventions que les rois ont conclus à son sujet, de choisir librement ses liens d’allégeance avec tel ou tel État (ou même de créer son propre État). Avignon et le comtat Venaissin, la Savoie, le comté de Nice, Monaco et la rive gauche du Rhin furent rattachés à la France après que les habitants de ces territoires eurent pu se prononcer par plébiscite (encore qu’entre la théorie et la pratique il y ait souvent eu une certaine marge). Le principe implique aussi que chaque peuple, chaque nation puisse adopter le régime politique qui lui convient, à l’abri de toute intervention étrangère. À la limite, c’est la conception de l’État-nation.Au XIXe siècle, et en particulier en 1848, le principe est invoqué avec force sous le couvert de celui des nationalités. Son champ d’application est limité à l’Europe, et il se manifeste par des tendances tantôt centripètes (Allemagne, Italie), tantôt centrifuges. Ces dernières, qui apparaissent surtout en Europe centrale et orientale, sont contrôlées par le concert des chancelleries européennes (ou ce qu’on appelle le droit public européen), qui prétendent sanctionner — et à certaines conditions seulement — la naissance de nouveaux États. Il convient d’indiquer que, pendant la même époque, des démocrates comme John Stuart Mill se sont montrés peu favorables à l’atomisation de la société internationale et aux revendications de tant de petites nationalités plus ou moins retardées.Avant et pendant la Première Guerre mondiale, Lénine, dans ses polémiques avec Rosa Luxemburg et les austro-marxistes, soutient le droit inconditionnel des nations à disposer d’elles-mêmes. Le droit de sécession est d’ailleurs inscrit dans la Constitution soviétique, mais son exercice ne pouvait que se heurter sans doute à des obstacles de fait. Lénine a d’ailleurs précisé que le droit au divorce ne comporte pas l’obligation de divorcer. Dès ses débuts, le gouvernement soviétique fait de l’autodétermination, ou plutôt de son application aux colonies, un principe essentiel de sa politique étrangère et de sa propagande internationale.Dans ce domaine, les quatorze points de Wilson sont beaucoup plus timides. On ne peut guère affirmer que les grands traités qui marquent la fin de la Première Guerre mondiale reconnaissent systématiquement la validité du principe. Le rapport de la commission de juristes nommée par le Conseil de la S.D.N. dans l’affaire des îles Åland (1920) constate que le principe ne se trouve pas inscrit dans le pacte de la S.D.N. et affirme qu’il ne saurait être considéré «comme une règle positive du droit des gens». En revanche, «le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes» s’impose à tous les membres des Nations unies, en vertu des articles 1er et 55 de la Charte. On a discuté la portée du principe. Par des déclarations solennelles qui peuvent être considérées comme des interprétations authentiques de la Charte, l’Assemblée générale de l’O.N.U. a affirmé qu’il s’agit d’un principe juridique fondamental (résolutions 1514-XV et 2625-XXV; voir aussi les deux pactes internationaux sur les droits de l’homme, 1966, article 1er). Certains estiment même qu’il relève du jus cogens . Il en découle que l’intervention contre un mouvement de libération nationale est illégale, tandis qu’est légale l’assistance militaire à un tel mouvement.Qui est le titulaire de l’autodétermination? Qu’est-ce qu’un peuple ou une nation? L’application du principe ne conduit-elle pas à des sécessions sans fin? Suivant la pratique, il s’agit de peuples ou de nations désirant se libérer du joug colonial. Mais quand ce processus est parachevé, les États nouveaux, dont la plupart doivent réaliser leur intégration nationale après leur accession à l’indépendance, s’opposent, notamment à l’O.N.U., à toute sécession ultérieure et invoquent à cet effet le principe de l’intégrité territoriale (art. 2, paragraphe 4 de la Charte).La libre disposition implique-t-elle l’application de méthodes déterminées, tel le plébiscite? D’après les accords d’Évian du 19 mars 1962, l’indépendance algérienne et l’application des accords, à l’exception du chapitre concernant le cessez-le-feu, étaient subordonnées à la consultation d’autodétermination du peuple algérien, qui s’est prononcé par référendum le 1er juillet 1962. Mais il n’y a aucune règle internationale obligatoire relative à l’adoption d’une telle méthode.Voici quelque temps, le principe s’est étendu au domaine économique, et les Nations unies ont proclamé la souveraineté permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles (résolution 1803-XVII de l’Assemblée générale et 1737-LIV du Conseil économique et social, pactes internationaux sur les droits de l’homme, 1966, art. 1er). Ce principe tend à subordonner l’exploration, l’exploitation et la gestion des ressources aux lois et règlements nationaux et à soustraire ces opérations aux ingérences, juridiques ou de fait, des entités étrangères.
autodétermination [ otodetɛrminasjɔ̃ ] n. f.• 1955 polit.; 1907 biol.; de auto- et détermination♦ Détermination du statut politique d'un pays par ses habitants. « la thèse du général de Gaulle n'a jamais été l'intégration, mais l'autodétermination » (Lartéguy).
● autodétermination nom féminin Action de décider par soi-même, et, en particulier, action par laquelle un peuple choisit librement son statut politique et économique.autodéterminationn. f. Fait, pour un peuple, de déterminer par lui-même, librement, son statut international, politique et administratif. Le droit à l'autodétermination s'inscrit dans la Charte des Nations unies (droit des peuples à disposer d'eux-mêmes).⇒AUTO(-)DÉTERMINATION, (AUTODÉTERMINATION, AUTO-DÉTERMINATION) subst. fém.A.— PSYCHOL. Le fait de fixer par soi-même ses choix, ses actes, etc. :• 1. La description du projet comme ouverture de possibles dans le monde et surtout celle de l'imputation du moi comme autodétermination pourrait en effet insinuer le sentiment que la volonté est un décret arbitraire.RICŒUR, Philos. de la volonté, 1949, p. 64.B.— POL. Droit d'une collectivité, d'une population à se donner un statut politique tel qu'elle assume en pleine souveraineté la responsabilité de sa vie publique :• 2. On est ici sur un terrain sûr, et tout le développement religieux d'Israël, même avec la conviction qu'un maître suprême régit le destin des peuples et des individus, repose sur le sentiment profond, inébranlable de son auto-détermination, donc de sa propre responsabilité dans ses défaillances comme de son aptitude à se forger à lui-même, avec l'aide de Dieu, son avenir.WEILL, Le Judaïsme, 1931, p. 106.• 3. Ils mettent en contact des groupes humains politiquement et administrativement structurés, dans la métropole, avec des groupes humains qui se structurent, politiquement et administrativement, dans les pays en voie de développement rapide et tendant à l'auto-détermination politique.PERROUX, L'Écon. du XXe s., 1964, p. 273.Rem. 1. 1re attest. a) biol. 1907 (Théorie de W. Roux ds Nouv. Lar. ill. Suppl.); b) pol. 1931 (supra ex. 2); c) psychol. 1949 (supra ex. 1); dér. de détermination, élément préf. auto-1. 2. Noter aussi le verbe autodéterminer (s') (1970, Courrière ds GILB. 1971).PRONONC. :[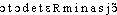 ] ou [
] ou [ ] ou [oto-] (DUB.). Cf. auto-1.STAT. — Fréq. abs. littér. :8.BBG. — NEYRON 1970 (s.v. autodétermination). — Pol. 1969 (s.v. autodétermination).autodétermination [otodetɛʀminɑsjɔ̃] n. f.❖1 Le fait de se déterminer, d'être déterminé par des caractères internes. || Autodétermination et liberté humaine.♦ Biologie :1 En fait, comme on l'a vu, lorsque ces performances sont analysées à l'échelle microscopique, moléculaire, elles apparaissent entièrement interprétables en termes d'interactions chimiques spécifiques, électivement assurées, librement choisies et organisées par des protéines régulatrices; et c'est dans la structure de ces molécules qu'il faut voir la source ultime de l'autonomie, ou plus exactement de l'autodétermination qui caractérise les êtres vivants dans leurs performances.Jacques Monod, le Hasard et la Nécessité, p. 104.2 (1955; dans le contexte algérien). Cour. Détermination du statut politique d'un pays par ses habitants. || Le droit à l'autodétermination.2 J'y vois, quant à moi, la preuve que l'adversaire ne se dérobe pas, comme nous l'avions craint. Il attend (et comment s'en étonner ?) des assurances touchant les conditions et les garanties de l'autodétermination : « Si le peuple algérien doit librement se prononcer, il est légitime de s'interroger sur les greffiers chargés d'enregistrer statistiquement sa sentence, et sur l'identité de l'huissier appelé à l'exécuter ».F. Mauriac, le Nouveau Bloc-notes 1958-1960, p. 273.3 Vous saurez (…) lui faire comprendre que la thèse du général de Gaulle n'a jamais été l'intégration, mais l'autodétermination.Jean Lartéguy, les Prétoriens, p. 672.♦ Libre détermination par les membres d'une collectivité de leur orientation. || L'autodétermination des élèves d'un lycée.❖DÉR. Autodéterminer (s').
] ou [oto-] (DUB.). Cf. auto-1.STAT. — Fréq. abs. littér. :8.BBG. — NEYRON 1970 (s.v. autodétermination). — Pol. 1969 (s.v. autodétermination).autodétermination [otodetɛʀminɑsjɔ̃] n. f.❖1 Le fait de se déterminer, d'être déterminé par des caractères internes. || Autodétermination et liberté humaine.♦ Biologie :1 En fait, comme on l'a vu, lorsque ces performances sont analysées à l'échelle microscopique, moléculaire, elles apparaissent entièrement interprétables en termes d'interactions chimiques spécifiques, électivement assurées, librement choisies et organisées par des protéines régulatrices; et c'est dans la structure de ces molécules qu'il faut voir la source ultime de l'autonomie, ou plus exactement de l'autodétermination qui caractérise les êtres vivants dans leurs performances.Jacques Monod, le Hasard et la Nécessité, p. 104.2 (1955; dans le contexte algérien). Cour. Détermination du statut politique d'un pays par ses habitants. || Le droit à l'autodétermination.2 J'y vois, quant à moi, la preuve que l'adversaire ne se dérobe pas, comme nous l'avions craint. Il attend (et comment s'en étonner ?) des assurances touchant les conditions et les garanties de l'autodétermination : « Si le peuple algérien doit librement se prononcer, il est légitime de s'interroger sur les greffiers chargés d'enregistrer statistiquement sa sentence, et sur l'identité de l'huissier appelé à l'exécuter ».F. Mauriac, le Nouveau Bloc-notes 1958-1960, p. 273.3 Vous saurez (…) lui faire comprendre que la thèse du général de Gaulle n'a jamais été l'intégration, mais l'autodétermination.Jean Lartéguy, les Prétoriens, p. 672.♦ Libre détermination par les membres d'une collectivité de leur orientation. || L'autodétermination des élèves d'un lycée.❖DÉR. Autodéterminer (s').
Encyclopédie Universelle. 2012.
